Le cadre réglementaire français définit précisément les techniques utilisées pour l’assainissement des eaux usées domestiques et les conditions de mise en œuvre de ces techniques. La distinction faite entre assainissement collectif et assainissement non collectif étant la spécificité majeure, la possibilité de réaliser un assainissement par filtres plantés dépend donc pour l’instant, de la catégorie dans laquelle on se situe : assainissement collectif ou non collectif.
Assainissement collectif
Par assainissement collectif, on caractérise une installation située sur un terrain public et réalisée sous maîtrise d’ouvrage publique, assurant la collecte, le pré-retraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques de tout ou partie des habitants d’une commune. Son cadre réglementaire est défini par l’arrêté du 22 décembre 1994 pour les systèmes d’assainissement collectif supérieurs à 2000 Equivalents-Habitants (EH), et par l’arrêté du 21 juin 1996 pour les systèmes d’assainissement intérieur à 2000 EH.
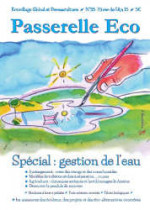
Passerelle Eco n°55 - Janvier de l’An 15
Bonne gestion de l’eau : création de mares et d’étangs, toilettes sèches à séparation des urines et à litières biomaîtrisées, épuration, eau de pluie, agriculture (chinampas, hortillonage), (...)Obligations de résultat
Ces arrêtés exigent des obligations de résultat sur différents paramètres caractérisant les eaux usées mais aucune obligation de moyens. Par conséquent, l’ensemble des techniques disponibles sur le marché, des plus lourdes (boues activées) aux plus légères (filtres plantés), peut être mis en œuvre en toute légalité.
L’assainissement semi-collectif
L’assainissement couramment appelé semi-collectif ne correspond à aucune catégorie juridique. C’est en fait une notion technique qui désigne une installation d’assainissement commune à un habitat dit regroupé : hameau, camping, gîtes... L’installation peut être publique (assainissement collectif) ou privée (assainissement non collectif). L’assainissement d’un habitat regroupé par filtres plantés peut être légalement mis en œuvre, que l’installation soit publique ou privée, car l’article 14 de l’arrêté du 6 mai 1996 précise que « l’assainissement de ces immeubles [ensembles immobiliers et installations diverses, quelle qu’en soit la destination, à l’exception des maisons d’habitation individuelles] peut relever soit des techniques admises pour les maisons d’habitations individuelles […], soit des techniques mises en œuvre en matière d’assainissement collectif ».
Assainissement non collectif
L’assainissement non collectif est juridiquement défini comme « tout système d’assainissement effectuant la collecte, le pré-retraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés au réseau public d’assainissement ». C’est donc un système d’assainissement se trouvant sur un terrain privé et réalisé sous maîtrise d’ouvrage privée. On parle également d’assainissement autonome. Le cadre réglementaire de l’assainissement non collectif est défini par l’arrêté du 6 mai 1996, qui exige des obligations de moyens mais non de résultats. Ainsi les techniques à utiliser y sont décrites de façon précise et exhaustive laissant peu de place à l’innovation (pré-retraitement par fosse toutes eaux et épandage souterrain après passage éventuel dans un filtre à sable). Les technologies alternatives telles que les filtres plantés ne sont pas des filières réglementaires et leur mise en oeuvre ne peut être accordée qu’à titre dérogatoire par le maire qui est seul responsable de l’assainissement sur sa commune. En conséquence, le développement des filtres plantés pour l’assainissement autonome est beaucoup plus limité à l’heure actuelle que pour l’assainissement collectif.
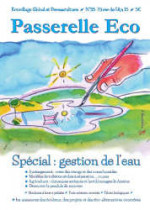
Passerelle Eco n°55 - Janvier de l’An 15
Bonne gestion de l’eau : création de mares et d’étangs, toilettes sèches à séparation des urines et à litières biomaîtrisées, épuration, eau de pluie, agriculture (chinampas, hortillonage), (...)Épuration d’effluents par filtres plantés
Enfin, il faut noter que les procédés d’épuration d’effluents par filtres plantés ont été adaptés pour le traitement des effluents d’origine agricole ou agroalimentaire : effluents de cage, de laiterie, de boulange... Ces exemples ne seront pas développés ici car ils n’entrent pas dans le cadre des eaux usées domestiques.














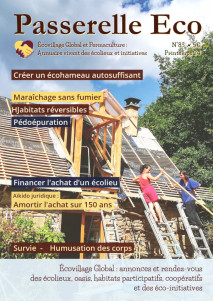
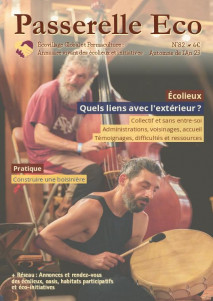

Bonjour, Je suis un peu étonnée par votre article. Je fais construire et j’ai demandé une phyto-épuration qui m’a été accordée. Cette phyto sera faite par Aquatiris, société qui a obtenu l’agrément du ministère pour faire des phyto-épuration individuelles. Dans la Nièvre, ce n’est pas le Maire qui autorise mais la SPANC. Je pense que c’est sujet à l’appréciation de la personne qui étudie le dossier. A ma connaissance, Aquatiris est la seule société agréée pour faire ce type d’assainissement.